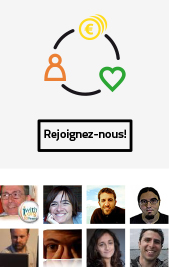17/09/2021 - Le ROADDH lance l’étude sur la situation des Femmes défenseurs et autres défenseurs des droits humains en Afrique de l’ouest
Le Réseau ouest africain des défenseurs des droits humains (ROADDH) a procédé le vendredi 30 juillet 2021 à son secrétariat à Lomé au lancement de « l’étude sur la situation des Femmes défenseures et autres défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l’ouest ». Un lancement fait en webinaire avec l’ensemble des organisations membres du ROADDH que sont les Coalitions.
Ce rapport vient faire un état des lieux de la situation des Femmes défenseures des droits humains en Afrique de l’ouest mais aussi des Défenseurs des droits humains les plus vulnérables. Il vient mettre en lumière les violations et défis spécifiques auxquels font face les Femmes défenseures des droits humains et les Défenseurs des droits humains les plus vulnérables dans 6 pays de l’Afrique de l’ouest que sont : le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria ; le Sénégal et la Sierra Léone ainsi que le contexte politique qui consiste à fragiliser ou protéger leur travail.
Un rapport qui intervient 5 ans après le rapport de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) sur la situation des femmes défenseures des droits humains. Il vient confirmer que les Défenseurs des droits humains, malgré la contribution de leur travail à la construction de sociétés inclusives, sont très exposés, car menant leurs actions souvent au prix de nombreux risques. Des risques aggravés lorsqu’il s’agit des Femmes défenseures des droits humains ou des défenseurs appartenant aux groupes vulnérables et en raison de leur statut social et des sujets sensibles sur lesquels ces défenseurs travaillent.
Pour la Directrice de Programmes et Plaidoyer au ROADDH Mélanie SONHAYE-KOMBATE, c’est un long processus qui a permis d’arriver à ce résultat d’où toute sa reconnaissance envers le partenaire financier de cette étude Foundation for a just society (FJS) et au Consultant ainsi que toute son équipe.
Malgré que l’étude soit effectuée dans 6 pays de l’Afrique de l’ouest, l’ensemble des pays ouest africains, ont apporté leurs contributions pour l’enrichir au cours d’un atelier de validation.
Les recommandations présentées à la fin de l’étude tentent d’apporter une solution aux problèmes identifiés dans la sous-région sur la base de questionnaires qui cible les problèmes relatifs au vide ou à l’insuffisance juridique pour la protection des Défenseurs des droits humains et des Femmes défenseures des droits humains au plan national. Aussi, notons l’inexistence d’un statut juridique clair reconnu à ces acteurs en droit interne, l’existence de lois nationales qui entravent le travail des Femmes défenseures des droits humains et des Défenseurs des droits humains les plus vulnérables. A ces faits, il y’a les dérives autoritaires sous couvert de la lutte anti-terroriste brimant les droits des Femmes défenseures des droits humains, la réticence de la plupart des Etat à domestiquer la Déclaration des Nations Unies sur les Défenseurs des droits humains de 1998.
Commanditée par le Réseau ouest africain des défenseurs des droits humains, la Coalition Burkinabè des droits humains et la Coalition ivoirienne des droits humains avec le soutien financier de « Foundation for a just society », cette étude se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Renforcement de la promotion et de la protection des Femmes défenseures et autres défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l’ouest ». Elle met en lumière à la suite du rapport de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de 2014, les défis persistants, mais aussi les nouveaux défis que rencontrent les Défenseurs des droits humains ; en particulier les Femmes défenseures et les défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l’ouest.
14/09/2021 - Le ROADDH fait le point des activités réalisées à la 65è session de la CADHP
Le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH) a organisé le 19 octobre dernier à Banjul en Gambie un événement parallèle en marge de la 65ème session de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), une rencontre qui a mis en exergue les difficultés rencontrées par les Femmes Défenseurs de Droits de l’homme (FDDH) et les Défenseurs des Droits de l’homme (DDH) les plus vulnérables.
Cette activité a réuni plusieurs FDDH et DDH vulnérables venus de plusieurs pays de l’Afrique de l’ouest à savoir : la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Niger, le Nigéria, la Mauritanie le Togo. Elle a connu la participation effective de deux Rapporteurs spéciaux de la CADHP Lucy Asuagbor, chargée des droits des femmes et Rémy Ngoye Lumbu, chargé de la question des défenseurs des droits de l’homme.
La « sécurité des DDH de l’Afrique de l’Ouest dans un contexte de terrorisme ou un environnement non sécurisé a été au centre des débats durant cette rencontre au cours de laquelle la Directrice de programmes et plaidoyers du secrétariat du ROADDH, Mélanie SONHAYE-KOMBATE a mis en exergue les problèmes rencontrés par les FDDH et les DDH Vulnérables. Ces derniers n’ont pas manqué de faire un plaidoyer à l’endroits des deux Commissaires de la CADHP afin qu’ils fassent des recommandations aux Etats.
Les débats ont particulièrement tourné autour de la vulnérabilité des DDH en raison de contextes basés sur la question de l’esclavage des temps contemporains particulièrement sensibles pour certains Etats et les différentes attaques de certaines autorités ou leaders religieux contre le DDH en général, allant des menaces aux peines privatives de liberté dans des prisons isolées et loin de leurs proches.
Il a été également relevé, les risques élevés encourus par les DDH travaillant sur les questions de minorités sexuelles, les droits de la femme et de la jeune fille, le travail du DDH dans un contexte de terrorisme ou de crise sociopolitiques, ou encore dans le cadre des entreprises en relation avec les droits de l’homme.
Cette activité qui entre dans le cadre d’un programme dont le projet III est consacré au plaidoyer, et co-exécuté par le ROADDH, la Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits Humains (CIDDH) et la Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH). Il a pour objectif de mener un plaidoyer auprès de la CADHP pour l’amélioration de la protection et la sécurité FDDH et DDH vulnérables dans la sous-région.
Il est important de noter que malgré la dynamique enclenchée par certains pays pour la domestication de la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme, les FDDH et DDH de la sous-région ouest africaine continuent de payer un lourd tribut dans l’exercice de leur travail. Les violations de leurs droits ont atteint leur paroxysme et allant jusqu’aux atteintes à leurs vies.
En rappel cette rencontre a reçu le soutien financier de Foundation for a Just Society (FJS)
30/07/2021 - Le ROADDH lance l’étude sur la situation des Femmes défenseurs et autres défenseurs des droits humains en Afrique de l’ouest
Le Réseau ouest africain des défenseurs des droits humains (ROADDH) a procédé le vendredi 30 juillet 2021 à son secrétariat à Lomé au lancement de « l’étude sur la situation des Femmes défenseures et autres défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l’ouest ». Un lancement fait en webinaire avec l’ensemble des organisations membres du ROADDH que sont les Coalitions.
Ce rapport vient faire un état des lieux de la situation des Femmes défenseures des droits humains en Afrique de l’ouest mais aussi des Défenseurs des droits humains les plus vulnérables. Il vient mettre en lumière les violations et défis spécifiques auxquels font face les Femmes défenseures des droits humains et les Défenseurs des droits humains les plus vulnérables dans 6 pays de l’Afrique de l’ouest que sont : le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria ; le Sénégal et la Sierra Léone ainsi que le contexte politique qui consiste à fragiliser ou protéger leur travail.
Un rapport qui intervient 5 ans après le rapport de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) sur la situation des femmes défenseures des droits humains. Il vient confirmer que les Défenseurs des droits humains, malgré la contribution de leur travail à la construction de sociétés inclusives, sont très exposés, car menant leurs actions souvent au prix de nombreux risques. Des risques aggravés lorsqu’il s’agit des Femmes défenseures des droits humains ou des défenseurs appartenant aux groupes vulnérables et en raison de leur statut social et des sujets sensibles sur lesquels ces défenseurs travaillent.
Pour la Directrice de Programmes et Plaidoyer au ROADDH Mélanie SONHAYE-KOMBATE, c’est un long processus qui a permis d’arriver à ce résultat d’où toute sa reconnaissance envers le partenaire financier de cette étude Foundation for a just society (FJS) et au Consultant ainsi que toute son équipe.
Malgré que l’étude soit effectuée dans 6 pays de l’Afrique de l’ouest, l’ensemble des pays ouest africains, ont apporté leurs contributions pour l’enrichir au cours d’un atelier de validation.
Les recommandations présentées à la fin de l’étude tentent d’apporter une solution aux problèmes identifiés dans la sous-région sur la base de questionnaires qui cible les problèmes relatifs au vide ou à l’insuffisance juridique pour la protection des Défenseurs des droits humains et des Femmes défenseures des droits humains au plan national. Aussi, notons l’inexistence d’un statut juridique clair reconnu à ces acteurs en droit interne, l’existence de lois nationales qui entravent le travail des Femmes défenseures des droits humains et des Défenseurs des droits humains les plus vulnérables. A ces faits, il y’a les dérives autoritaires sous couvert de la lutte anti-terroriste brimant les droits des Femmes défenseures des droits humains, la réticence de la plupart des Etat à domestiquer la Déclaration des Nations Unies sur les Défenseurs des droits humains de 1998.
Commanditée par le Réseau ouest africain des défenseurs des droits humains, la Coalition Burkinabè des droits humains et la Coalition ivoirienne des droits humains avec le soutien financier de « Foundation for a just society », cette étude se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Renforcement de la promotion et de la protection des Femmes défenseures et autres défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l’ouest ». Elle met en lumière à la suite du rapport de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de 2014, les défis persistants, mais aussi les nouveaux défis que rencontrent les Défenseurs des droits humains ; en particulier les Femmes défenseures et les défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l’ouest.
29/07/2021 - La CTDDH boucle les rencontres trimestrielles avec les FDDH et DDHV
Les rencontres trimestrielles de la Coalition togolaise des défenseurs des droits humains (CTDDH) à l’endroit des femmes défenseures des droits humains (FDDH) et des défenseurs des droits humains (DDH) vulnérables ont pris fin ce jeudi 29 juillet à Lomé. Les rencontres sont un cadre d’échange et de renforcement des capacités des FDDH et des DDH vulnérables.
Une douzaine de FDDH et un DDDH vulnérable ont participé ce jeudi 29 juillet à Lomé à la dernière rencontre trimestrielle à leur endroit Ces rencontres visent à créer un cadre d’échanges entre les différents DDH pour la mise en place d’un mécanisme de protection des DDH surtout les plus vulnérables.
Deux communications ont permis aux participants d’échanger sur la notion de défenseur des droits humains, et sur la cyberintimidation, un concept nouveau qui compromet la carrière de plusieurs DDH.
Selon Bruno HADEN, consultant en Management des organisations et droit de l’Homme, il s’agit de « rappeler aux défenseurs des droits humains que toute loi qui doit être faite, doit répondre à la déclaration des Nations-Unies sur les droits de l’homme de 1998, sur les défenseurs des droits humains, et rappeler les b à bas de la sécurité physique et numérique »
« La cyberintimidation’’ est de plus en plus un phénomène auquel les femmes font face et pour lequel elles devraient prendre des dispositions Le taux de la cyberintimidation est de plus en plus élevé dans le cyberespace togolais, et les FDDH peuvent être exposées à ces risques dans l’exercice de leur engagement », a expliqué M. Haden.
Après avoir rappelé la genèse du projet des rencontres trimestrielles, le président de la CTDDH, Bonaventure MAWUVI a invité les participants à travailler pour renforcer la protection et la prévention des FDDH et des DDH vulnérables dans un contexte sécuritaire éprouvé.
Pour information, les rencontres trimestrielles ont bénéficié de l’appui financier de la Fondation For a Just Society avec l’appui technique du Réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains (ROADDH), de la Coalition ivoirienne des droits humains, et de la Coalition Burkinabé des défenseurs des droits humains.
Yempabe LAMBONI
31/05/2021 - Irene Khan demande aux autorités togolaises d’assurer la protection des responsables des journaux L’Alternative, Liberté, Fraternité et L’Indépendance Express, de diligenter des enquêtes sur les violations subies et de traduire leurs responsables en justi
La Rapporteuse Spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression de l’ONU Mme Irene Khan conformément à la résolution 43/3 du Conseil des droits de l’homme qui institue son mandat a adressé une communication au gouvernement togolais le 19 mars dernier afin d’obtenir des réponses sur des cas d’allégations dont elle a été saisie. Mme Irene Khan souhaitait avoir dans un délai de 60 jours selon la règlementation en vigueur, des éclairages sur « la suspension des journaux L’Alternative, Liberté et Fraternité et le retrait du récépissé du journal L’Indépendant Express suite à des articles de presse critiques, y compris à l’égard de membres du gouvernement ou de représentant étrangers dans le pays ». Deux mois après sa demande, aucune réponse ne lui a été envoyée par les autorités togolaises, d’où la publication de cette communication.
Mme Irene exprime dans sa communication adressée aux autorités togolaises que les sanctions prises contre les journalistes « ne semble pas répondre aux exigence de légalité, nécessité et proportionnalité, prévues à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Togo a accédé le 30 mars 1988 ».
La Rapporteuse Spéciale se dit très préoccupée par le manque de clarté des décisions de la Haute autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) quant aux dispositions légales que les journaux mis en cause auraient violées.
La Rapporteuse Spéciale est davantage préoccupée par l’utilisation de la réglementation en vigueur sur la diffamation, qui lorsque celles-ci n’est par rigoureusement définie, peut être utilisée de manière abusive afin de sanctionner illégalement ou arbitrairement des journalistes et les entraver dans leur mission d’information du public.
Mme Khan demande au gouvernement d’annuler les décisions de suspension et de retrait de récépissé des journaux susmentionnés, de procéder au cas échéant à ce que les journaux obtiennent compensation pour toute violation indue à leurs droits, et de leur permettre d’exercer leur liberté d’expression dans le cadre défini par le droit international des droits de l’homme.
Elle se dit profondément préoccupée que les autorités semblent avoir été plus promptes à faire cesser la publication de reportages critiques, plutôt que d’envisager d’ouvrir des enquêtes sur les allégations sérieuses de corruption.
La Rapporteuse Spéciale rappelle que le Comité des droits de l’homme avait formulé des inquiétudes quant à des « restrictions injustifiées de la liberté d’expression, notamment la censure de certains médias par la HAAC dont l’indépendance et les modalités de fonctionnement ont été mises en cause », ainsi que celle de la précédente Rapporteur spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme qui, suite à sa visite au Togo en 2014, a rappelé les préoccupations quant au « manque de clarté des principes régissant la procédure de la HAAC et affirme que la HAAC a arbitrairement sanctionné les journalistes dans l’exercice de leur liberté d’expression et d’opinion précédemment formulé par son mandat. Elle encourage à une indépendance de l’autorité de règlementation des médias, « une condition indispensable afin qu’elle puisse exercer son mandat dans la rigueur de la loi et avec la confiance des citoyens ».
Mme Irene Khan n’a pas manqué d’exprimer ses inquiétudes sur les restrictions accrues à la liberté de presse au cours des derniers mois au Togo. Elle demande des clarifications concernant les allégations d’actes d’intimidation contre des journalistes qui nécessitent l’ouverture d’une enquête prompte et approfondie afin que les responsables soient traduits devant la justice et que les journalistes puissent exercer leur travail sans crainte de représailles.
Lire en intégralité la Communication de La Rapporteuse Spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression
19/02/2021 - Le ROADDH fait le point des activités réalisées à la 65è session de la CADHP
A quelques mois de la fin de son projet dénommé « Consolider le rôle de la société civile dans la transition des standards africains des droits de l’homme aux pratiques », le Réseau ouest-africain des droits de l’homme (ROADDH) a présenté, ce jeudi à Lomé, les activités déjà réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet au cours d’une conférence de presse.
Ce projet communément appelé PANAF, dont une partie est exécutée par le ROADDH, vise à renforcer le rôle de la société civile dans l’implémentation des décisions et recommandations de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Comme activités réalisées, le ROADDH a élaboré et présenté des rapports sur la situation des droits de l’homme et des défenseurs des droits de l’homme (DDH) dans la sous-région ; assurer le déplacement de quelques DDH au forum des ONG et à deux sessions de la commission ; accompagner et guider des ONG participant à ces activités pour la première fois.
Selon Mme Mélanie Sonhaye-Kombaté, directrice de programmes et plaidoyer au RAODDH, ce déplacement a permis aux défenseurs des droits de l’homme de faire l’expérience du forum des ONG, son déroulement, les différents acteurs qui y interviennent mais surtout les opportunités que le forum des ONG présente. Occasion pour les défenseurs d’évoquer directement des questions de violation des droits de l’homme, des questions d’adoption des lois nationales de protection des défenseurs des droits de l’homme, la question des défenseurs des droits de l’homme les plus vulnérables, les femmes y compris.
« Des contacts directs ont été établis entre les défenseurs des droits de l’homme et les mandats parmi lesquels le mandat sur les DDH en Afrique point focal de la CADHP sur les représailles celui sur les droits des femmes entre autres a précisé Mme Sonhaye-Kombaté.
Au cours de cette sortie médiatique, le ROADDH a diffusé un film documentaire dans lequel des DDH, ayant participé au forum des ONG à la 65ème session de la CADHP, ont expliqué les avantages retirés de ces rencontres et l’impact sur leur façon d’aborder les questions de plaidoyer.
Par ailleurs, le ROADDH recommande vivement aux ONG des droits de l’homme de solliciter le statut d’observateur auprès de la CADHP afin de contribuer à l’émergence d’une culture de droits dans la sous-région.
En rappel, le projet de « consolidation du rôle de la société civile dans la transition des standards africains des droits de l’homme aux pratiques » est un projet d’envergure panafricaine porté par un consortium de trois organisations à savoir le centre africain pour la démocratie les études des droits de l’homme (ACDHRS), la commission internationale des juristes et le ROADDH.
Boris Cyriaque
25/05/2020 - Burkina Faso : Le ROADDH dénonce un contre-terrorisme imprégné d’un génocide silencieux sur les peuls
Le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH) dont le Secrétariat est basé à Lomé au Togo dénonce un contre-terrorisme imprégné d’un génocide silencieux sur les peules au Burkina Faso. C’est à travers un communiqué rendu public ce jour, que l’organisation de défense des droits de l’homme attire l’attention des autorités burkinabés sur les régressions que connait le pays et propose des pistes de solutions pour pallier à cet état de fait au pays des hommes intègres.
Ci-dessous l’intégralité du communiqué du ROADDH
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH) dénonce un contre-terrorisme imprégné d’un génocide silencieux sur les peules au Burkina Faso. Depuis plus de cinq ans, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes menées par des groupes endogènes armés ou issus des pays voisins, où les populations et les forces de défense et de sécurité ont payé un lourd tribut. Des attaques, des enlèvements, des assassinats de populations et de corps habillés et le harcèlement subi par les agents de l’État ont entraîné des déplacements internes et internationaux massifs de populations occasionnant une crise humanitaire jamais connue dans le pays. Face à cette situation, les autorités burkinabés ont riposté en engageant les différentes composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte anti-terroriste. Cependant, aux côtés de celles-ci, il a été donné d’identifier des « groupes d’auto-défense », notamment les « Koglwéogo » et les « Dozo ». L’adoption par l’Assemblée Nationale d’une loi instituant le recrutement de « Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) », visant, selon le gouvernement, à « associer toutes les composantes de la société burkinabè à la lutte contre le terrorisme », le 21 janvier 2020 a permis à certains de ces acteurs de se convertir en VDP censés travailler sous la supervision des FDS et dans le strict respect des droits humains.
Alors que la mémoire collective demeure perturbée par les carnages occasionnés par les innombrables attaques terroristes et autres affrontements intercommunautaires, dont le massacre de plus de 200 personnes à Yirgou en janvier 2019, et, pendant que le pays se prépare à organiser des élections législatives le 22 novembre 2020, les populations assistent impuissantes à de nouvelles tueries. A titre d’exemple, on peut citer les cas suivants :
✓ Le 02 mars 2020, peu après la prière musulmane de 14h00, un groupe de VDP appuyé par des FDS apparemment venus de Djibo ont encerclé le village de Sicè, dans la commune de Pobé Mengao. Ce groupe, après avoir pris la majorité des gens à la mosquée, est allé de concession en concession pour finalement regrouper les 20 personnes dont les noms suivent : Dicko Abdoulaye, conseiller municipal, 50 ans ; Dicko Hamadoun, fils de Dicko Abdoulaye, 30 ans ; Dicko Hamadoun, 44 ans ; Dicko Idrissa, 63 ans ; Dicko Hamadoun Idrissa, 38 ans ; Dicko Harouna, 56 ans ; Dicko Hassane Harouna, 34 ans ; Dicko Djibril Harouna, 19 ans ; Dicko Mikaïlou, 50 ans ; Dicko Hamadoum Mamoudou, 30 ans ; Cissé Souaibou Adama, 33 ans ; Cissé Haadou, 68 ans ; Cissé Hamadoum Hassane, 37 ans; Cissé Boureima, 46 ans ; Cissé Abdoul Salam, 67 ans ; Sawadogo Soumsoré, sourd-muet, 45 ans ; quatre personnes toute issues de la même famille Tamboura. Ces personnes ont été toutes exécutées le même jour à la sortie du village sans autre forme de procès.
✓ A Namisigma, le 03 mai 2020, aux alentours de 10 heures du matin, Michailou Dicko, Ibrahim Dicko, Moussa Dicko, Oumarou Hall, Issa Boly, Ousmane Sita, Hassane Sondé, Hamadoum Dicko et Idrissa Dicko, soit 09 personnes qui abreuvaient leurs animaux au puits de Boulsi Baogo ont été froidement exécutées par les VDP à bord de 07 motos et armés de kalachnikov, dont certains ont été identifiés comme étant Zato Sawadogo, Nazilguiba Bamogo, Yoro Ouédraogo, Yembila Bamogo, Tasséré Sawadogo, Francis Sawadogo, Monré Ouédraogo, Prospère Sawadogo, Moumouni Sawadogo, Lassané Sawadogo, Mahamoudo Sawadogo et Pascal Sawadogo.
✓ Le même jour, à Namoungou village à une trentaine de km de la ville de Fada N’gourma, 02 jeunes transhumants venus acheter du couscous traditionnel sont arrêtés et tués par des FDS à la sortie du village.
✓ Entre le 1er et le 05 mai 2020, Diandé Ganni, Diandé Sambo, Diandé Issa, Diandé Moussa, Diandé Yacouba et Diandé Guibrila, Barry Idrissa, Diandé Amadou et son fils Diandé Adama sont interpellés par les VDP de Barsalogho, successivement dans les villages de Kamsé-peulh, Gabou et Sanrgo, sur des allégations de connivence avec des groupes terroristes. Les jours suivants, les corps de Barry Idrissa, Diandé Amadou et de son fils Diandé Adama sont retrouvés criblés de balles et abandonnés au bord de route, en rase campagne, alors que Diandé Moussa, souffrant lors de son interpellation meurt dans sa cellule de garde à vue.
✓ Pendant que les populations étaient déjà tétanisées par la situation ambiante, c’est le tour d’une quarantaine de personnes d’être interpelées le 11 mai 2020 au marché de Pentchangou, à cinq kilomètres de Tanwalbougou par la gendarmerie dirigée par le Commandant Sayouba SIMPORE. Alors que les parents des personnes interpelées s’activaient en vain pour rentrer en contact avec ces dernier, 12 corps saignants, emballés dans du plastique sont déposés à la morgue du CHR de Fada N’Gourma. Le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Fada, Judicaël KADEBA déclare le même jour que ces personnes sont suspectées de fait de terrorisme et font partie des « 25 personnes » interpelées dans la nuit du 11 au 12 mai 2020 à Tanwalbougou et « ont trouvé la mort au cours de la même nuit dans les cellules où elles étaient détenues ». Les faits ci-dessus évoqués démontrent que des FDS et des VDP, à l’origine en charge de la lutte contre le terrorisme, se distinguent actuellement par leur implication dans la stigmatisation des communautés et des faits graves d’atteintes aux droits humains, fragilisant ainsi le vivre ensemble.
Le ROADDH dénonce des exécutions extrajudiciaires contraires à l’Acte constitutif de l’Union Africaine, à la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples, au protocole à la convention de l’Union Africaine (ancienne OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, à la résolution 57/219 de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste et à la résolution S/RES/1456 (2003) du Conseil de Sécurité qui exige en son point 6 : « Lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire… » En outre, toutes ces exécutions extrajudiciaires de personnes non armées, spécifiquement d’ethnie peule par des FDS et des VDP, démontrent qu’un génocide silencieux est en cours sur ces populations, conformément à la définition telle que contenue dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l’assemblée générale des Nations Unies, en son article 2.
Face à cette situation, le Réseau demande aux autorités du Burkina Faso de :
1. Prendre des mesures urgentes pour protéger les populations Peulh, contre les exécutions extrajudiciaires afin de mettre un frein au génocide silencieux en cours.
2. Ouvrir une enquête indépendante afin d’identifier les agents des FDS et les VDP auteurs d’exécutions extrajudiciaires sur les populations, et situer les responsabilités conformément aux lois en vigueur afin que justice soit rendue aux victimes.
3. Renforcer les capacités des FDS et des VDP en contre-terrorisme dans le strict respect des droits de l’homme.
15/02/2019 - Le ROADDH vulgarise les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion
Une vingtaine de défenseurs des droits humains venu des Etats membres de la CEDEAO et de la Mauritanie participent, à Lomé les 14 et 15 février, à un atelier sur la liberté d’association et de réunion en Afrique. Cette rencontre initiée par le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits de l’Homme (ROADDH) vise à vulgariser et à s’approprier les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion sur le continent.
En Afrique de l’ouest, la liberté de manifestation et de réunion est confrontée à des restrictions. Au cours des travaux, les participants vont se familiariser avec le document contenant les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, adoptées lors de la 60è session ordinaire de la Commission Africaine des droits de l’homme et des Peuples tenue à Niamey en mai 2017.
Selon Mme Mélanie Kombaté-Sonhaye, directrice de programme et de plaidoyer au ROADDH, les organisations de défense des droits humains sont confrontées à des questions essentielles notamment de savoir si la jouissance de ce droit repose sur le régime d’autorisation ou sur celui de la déclaration. C’est important pour nous de comprendre, cette situation, l’évaluer et mieux vulgariser ces lignes directrices auprès de nos Etats
Elle a rappelé que la situation est plus inquiétante avec le terrorisme qui sert de prétexte aux Etats pour prendre des lois dont la finalité est la restriction de l’espace liberté de la société civile.
Pour promouvoir la liberté d’association et de réunion, il est très important, indique Mme Kombaté-Sonhaye, que les chefs d’Etat de la sous-région puissent comprendre qu’il existe des lignes directrices auxquelles ils doivent se conformer.
Précisons que cet atelier a bénéficié de l’appui technique et financier de International Center for Not for profit Law (ICNL)
Marie Hélène